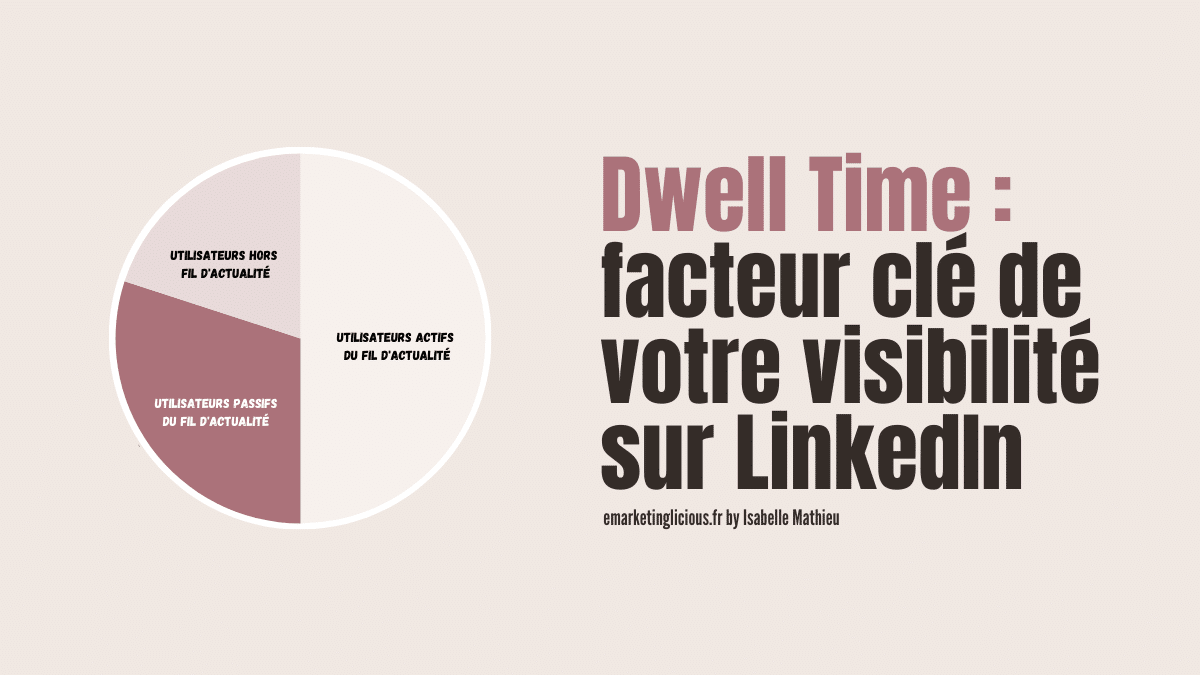Attirer l’attention dans le fil d’actualité, c’est le défi de chaque utilisateur qui publie sur LinkedIn.
Et pourtant, ce ne sont pas seulement les commentaires ou les partages qui comptent. Ce que vous ne voyez pas est tout aussi, sinon plus, important.
LinkedIn est récemment revenu sur un signal clé de son algorithme : le temps de consultation, ou “dwell time”. Depuis 2020, cet indicateur a évolué.
Ce qui n’était qu’un simple signe de contenu ignoré est aujourd’hui devenu un facteur essentiel pour évaluer la pertinence des contenus.
Chaque seconde que votre audience passe sur vos posts compte.
L’attention silencieuse de vos lecteurs joue désormais un rôle majeur dans la visibilité de vos publications.
Et c’est exactement ce que nous allons explorer ensemble. Voyons comment le « dwell time » peut redéfinir votre approche du contenu sur LinkedIn.
Qu’est-ce que le “dwell time” ou temps de consultation ?
Le “dwell time” désigne le temps que les utilisateurs passent à consulter un contenu sans forcément interagir.
Contrairement aux signaux explicites comme les mentions j’aime, les partages ou les commentaires, il s’agit d’un signal d’engagement passif.
Mais cela ne signifie pas pour autant que l’utilisateur n’est pas intéressé, bien au contraire ! Plus le temps de consultation est long, plus cela montre que le contenu réussit à capter son attention.
Cette distinction entre interactions explicites et implicites est essentielle pour comprendre la manière dont LinkedIn classe les publications.
Les interactions sont bien sûr importantes, mais elles ne couvrent qu’une partie des comportements des utilisateurs.
Beaucoup consomment du contenu de manière plus discrète, sans laisser de trace visible.
Et c’est là que le temps de consultation entre en jeu.
Il permet à LinkedIn de mesurer l’intérêt réel, en particulier pour les utilisateurs dits passifs, ceux qui ne commentent pas, mais passent du temps sur un post.
C’est aussi un indicateur clé pour les recommandations hors réseau, où les interactions explicites sont souvent moins fréquentes.
Comment fonctionne l’algorithme de LinkedIn ?
Le classement des contenus sur LinkedIn repose sur une architecture en 2 passes.
Concrètement, cela signifie que l’algorithme LinkedIn procède en 2 étapes.
D’abord, il récupère un large éventail de contenus potentiellement pertinents en fonction de votre réseau et de vos centres d’intérêt. Ensuite, il affine cette sélection en classant ces contenus de manière plus précise, selon divers signaux (temps de consultation, interactions explicites, etc.).
Cette logique est soutenue par un cadre appelé optimisation multi-objectifs (ou MOO), qui vise à trouver un équilibre entre plusieurs types d’engagements.
D’un côté, l’algorithme optimise pour les interactions passives (comme le dwell time) et actives (mentions j’aime, commentaires, partages). De l’autre, il prend en compte l’impact des actions des utilisateurs en aval, c’est-à-dire comment celles-ci influencent leur réseau. Enfin, il mesure aussi la valeur pour le créateur des contenus, en évaluant comment ces interactions bénéficient à l’auteur de la publication.
Ce système multi-objectifs permet à LinkedIn de maximiser à la fois la pertinence des contenus pour les utilisateurs et l’impact pour les créateurs. Il en résulte une expérience plus enrichissante et personnalisée pour l’ensemble des membres.
Les défis liés à la modélisation du « dwell time »
Bien que le « dwell time » soit un indicateur précieux, sa modélisation présente plusieurs défis.
D’abord, il faut gérer les signaux bruités. Le temps de consultation varie énormément d’un utilisateur à l’autre et d’un type de contenu à l’autre, ce qui crée des écarts difficiles à interpréter.
Par exemple, un utilisateur peut passer 10 secondes sur un article et en tirer l’essentiel, tandis qu’un autre peut regarder une vidéo de 30 secondes sans y prêter attention.
Résultat : l’algorithme peut avoir du mal à déterminer si un post a réellement capté l’attention ou si le temps passé dessus est simplement dû au hasard.
Ensuite, il y a l’absence de seuils adaptatifs. Pendant un temps, LinkedIn utilisait des seuils fixes pour définir ce qu’on considérait comme un « long temps de consultation ».
Le problème, c’est que ces seuils ne s’adaptent pas aux différentes catégories de contenus ni aux comportements des utilisateurs, ce qui limite leur efficacité.
Par exemple, un seuil fixe de 30 secondes pourrait être considéré comme un « long temps de consultation » pour une image ou un article court, mais serait bien trop faible pour une vidéo longue. Cela biaise l’évaluation de l’engagement réel en ne prenant pas en compte la nature du contenu.
Enfin, l’utilisation de seuils statiques introduit des biais dans le classement des contenus. Certains types de posts, comme les vidéos, ont naturellement un temps de consultation plus long que d’autres, comme les articles courts ou les images.
Cela peut fausser le classement en favorisant certains formats au détriment d’autres, même si ces derniers sont tout aussi pertinents pour l’utilisateur.
Introduction d’un modèle auto normalisé du temps de consultation long
Pour résoudre les défis liés à la modélisation du temps de consultation, LinkedIn a développé un modèle auto normalisé qui permet de mieux capter l’engagement des utilisateurs.
Plutôt que de s’appuyer sur des seuils fixes, ce modèle ajuste automatiquement la manière dont il évalue le « dwell time », en tenant compte des différences entre les types de contenu et les comportements des utilisateurs.
Le principe repose sur une classification binaire. Concrètement, l’algorithme compare la durée de consultation d’un post à celle de contenus similaires, afin de prédire si un utilisateur passera plus ou moins de temps que la moyenne. Ce système est bien plus fin que les anciennes méthodes, car il adapte ses prédictions à chaque contexte.
Grâce à des techniques de normalisation, le modèle réduit le bruit et les biais en identifiant les attributs clés comme le type de contenu, le créateur, et la méthode de distribution.
Cela permet à l’algorithme de mieux classer les posts, non pas en se basant uniquement sur le temps passé, mais en prenant en compte un ensemble de facteurs qui rendent l’évaluation plus juste et précise.
Impact sur l’ « engagement » des utilisateurs
Selon les résultats communiqués par LinkedIn, les tests A/B auraient montré une amélioration des indicateurs d’engagement des utilisateurs, incluant le nombre de sessions, le temps total passé sur la plateforme, ainsi que le temps passé par publication.
L’amélioration aurait été particulièrement marquée chez les utilisateurs qui consomment du contenu de manière passive, sans interactions explicites.
Conclusion
Je conclus cet article en vous proposant quelques pistes de réflexion :
- Tout d’abord, tordons le cou à l’idée que rédiger des posts interminables garantit un meilleur engagement. Ce n’est pas la longueur qui compte, mais bien la capacité à capter l’attention de manière authentique. Que ce soit avec des formats courts et percutants ou des contenus plus approfondis, l’important est de créer de la valeur pour l’audience.
- Ensuite, oubliez les tactiques de clickbait ou de dwellbait. LinkedIn valorise aujourd’hui le contenu de fond et l’engagement durable. Miser sur du contenu pertinent et sincère, qui répond réellement aux besoins de l’audience, est la clé pour maximiser la portée et l’impact sur le long terme. Souvenez-vous que le « dwell time » est un indicateur de la qualité du contenu.
- Enfin, expérimentez différents formats. Que ce soit des articles longs, des vidéos courtes ou des carrousels, l’important est de tester ce qui résonne le mieux avec votre audience. Chaque format peut générer des résultats différents. Le « dwell time » est essentiel pour maximiser la visibilité, tandis que les interactions explicites (mentions j’aime, commentaires, partages) créent un engagement immédiat. L’analyse de ces résultats doit guider vos ajustements stratégiques.
A votre tour maintenant
Que pensez-vous de l’utilisation du dwell time dans l’architecture actuelle de LinkedIn ? Quels sont les points que vous trouvez les plus intéressants ou les plus problématiques ? Pensez-vous que le fil d’actualité vous sert aujourd’hui des publications pertinentes ? Identifiez-vous du contenu clickbait ou dwellbait sur votre timeline ?